Quand « Le Monde » retourne à La Baule… (Par Mamoudou Ibra Kane)
samedi 16 août 2025 • 91 lectures • 0 commentaires
Blog
2 heures
![]() Taille
Taille
![]()

« Démocratisez-vous ! » Telle fut en substance l’injonction adressée par François Mitterrand aux dirigeants africains, le 20 juin 1990. Le président socialiste français choisit La Baule-Escoublac (ou Ar Baol-Skoubleg en breton - Wikipédia), une chic station balnéaire baignée par l’Océan atlantique, pour y tenir ce qu’on appela « Le sommet de La Baule ».
De Gaulle fit son appel du 18 juin (1940). Et Mitterrand, cinquante ans plus tard, prononça son discours du 20 juin. Pour ce qui est de ce dernier, les thèses et les antithèses s’entrechoquèrent et chaque chef d’Etat africain convié au banquet de la Françafrique, pardon France-Afrique, y alla de sa synthèse. Un printemps démocratique, marqué par des conférences nationales et des élections pluralistes, souffla sur une bonne partie du continent. Les plus ingénieux firent preuve de capacité d’adaptation insoupçonnée et réussirent à se maintenir au pouvoir, tandis que les moins chanceux furent balayés soit par les urnes, des coups d’Etat militaires ou encore des soulèvements armés jugés « salvateurs ». Des putschistes d’un genre nouveau troquèrent l’uniforme kaki contre le costume ou le boubou traditionnel, c’est selon.
Trente-cinq ans après La Baule, sous le titre : « Les Africains ont droit, eux aussi, à la démocratie », « Le Monde » version électronique refait… le match. A tout le moins, il en dresse un bilan dans son éditorial du 7 août 2025. Seulement, le curieux est le ton paternaliste adopté par le quotidien créé il y a plus de quatre-vingts ans. « L’éclipse démocratique africaine, tranche-t-il, a des causes multiples, parmi lesquelles les lourdes ambiguïtés de la France, prompte à adouber des despotes réputés amis et à réduire la démocratie à la tenue d’élections même truquées. »
« Au nom de Dieu, vive la coloniale ! », s’exclamerait encore aujourd’hui le père Charles de Foucauld. « Le Monde » voudrait-il faire de la France l’alpha et l’oméga de la question démocratique en Afrique qu’il ne s’y prendrait pas autrement. La volonté des peuples semble reléguée au second plan quand bien même l’éditorialiste tenterait d’édulcorer son propos en élargissant la palette : « Dans le monde entier, les régimes et les valeurs démocratiques subissent des attaques d’une ampleur sans précédent depuis 1945. »
Vrai qu’il y a une universalité certaine de l’aspiration à la démocratie et à la liberté (Réf. : Ousmane Ndiaye, L’Afrique contre la démocratie : Mythes, déni et péril, Riveneuve éditions). Vrai aussi que cette aspiration est malmenée un peu partout par la montée de « l’illibéralisme » et du populisme. Mais la réserve ne peut être que de mise lorsque « le journal de l’après-midi daté du lendemain » veut imposer un regard unipolaire sur le sujet démocratique. Le seul prisme occidental ne saurait suffire. Il faut une vision à 360° pour appréhender la donne tant dans sa dimension géographique qu’historique. Dans cette optique, il est utile de rappeler que la Charte du Mandé, du temps du royaume du Mali, et la Magna Carta ou Grande Charte d’Angleterre remonteraient toutes les deux au 13ème siècle, alors que la révolution de Thierno Souleymane Baal et la révolution américaine dateraient également de la même année 1776, précédant ainsi la révolution française de 1789.
Entendons-nous bien : le devoir de mémoire qui nous incombe ne remet nullement en cause la justesse de la remarque soulevée par « Le Monde » sur le cas particulier du continent africain. Nous convenons avec lui lorsqu’il écrit : « Cette reculade générale ne doit pas occulter le phénomène inquiétant et spécifique qui saisit de nombreux pays d’Afrique francophone, où les progrès vers le libre choix des dirigeants par les populations, enregistrés depuis les années 1990, sont remis en cause. Ce mouvement est marqué par la mise au pas des opposants, par une répression féroce, et, dans la zone sahélienne, par un huis clos consécutif à l’interdiction des médias indépendants et étrangers. »
Il est en effet difficile de nier que le jeu démocratique est faussé dans l’espace francophone de l’Afrique. Pire, il est tenu en joue au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Au Togo, au Tchad et au Cameroun, il ne se porte pas davantage mieux. Résultat : les militaires se « civilisent » et les civils se « militarisent ». C’est le monde (et la démocratie) à l’envers !
Que le journal Le Monde ne soit pas exhaustif dans le listing des pays en délicatesse avec le pluralisme politique, cela peut se comprendre. En revanche, ce qui est incompréhensible, c’est son omission volontaire de la situation potentiellement explosive en Côte d’Ivoire. A moins d’éprouver l’envie de paraphraser son fondateur Hubert Beuve-Méry* en écrivant à son tour, que « le président Alassane Dramane Ouattara apparaît comme le moindre mal, la moins mauvaise chance*», « Le Monde » ne peut ignorer l’élimination par des arguties juridiques des principaux leaders de l’opposition de la prochaine compétition électorale. Ce n’est un secret pour personne que Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ne figurent pas sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 octobre prochain. Etonnant et paradoxal que cela survienne sous la gouvernance d’un Alassane Ouattara qui a subi autrefois toutes sortes de brimades – la fameuse ivoirité - pour l’écarter de la vie politique ivoirienne. Parallèlement, le président ADO brigue un quatrième mandat suite à des modifications substantielles de la Constitution.
S’agissant du Sénégal, le quotidien de référence français, édition en ligne pour être précis, n’a pas tort de relever « l’exception sénégalaise ». C’est le jugement qui est régulièrement porté sur le pays du président Léopold Sédar Senghor. D’ailleurs, dans un autre éditorial publié le 5 juillet 2023 et intitulé : « Démocratie en Afrique : l’exception sénégalaise », le quotidien du soir écrivait ceci : « Le renoncement de Macky Sall à se présenter pour un troisième mandat à l’élection présidentielle en février 2024 est un soulagement et une source de fierté pour le Sénégal. Il ancre le pays dans le club de ceux où l’Etat de droit garantit la stabilité. » Mais le soulagement fut de courte durée. Que de soubresauts et de vacillements par la suite !
Il y a une exception à « l’exception sénégalaise » qui est souvent occultée : c’est la violation des libertés. Un paradoxe pour une démocratie qui se veut exemplaire. Les dérives autoritaires notées sous l’ancien régime se poursuivent avec l’actuel pouvoir. Le tandem Diomaye-Sonko s’illustre par de nombreux écarts liberticides : emprisonnements d’opposants, d’activistes, de chroniqueurs et même d’hommes d’affaires, asphyxie financière de la presse et convocations intempestives de journalistes, menaces contre la société civile, tentative de musellement de la magistrature… Certes la loi autorisant le président de l'Assemblée nationale à « requérir la force armée » pour entendre les magistrats a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais elle édifie à suffisance sur les visées du parti au pouvoir qui proclame, sans trembler, son projet d’instaurer un parti-Etat. L’intention vaut l’action, dit l’adage. « Le Projet » en cache un autre.
Qu’est-ce qui justifie le silence éditorial sur les cas particuliers du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ? « Le Monde » est plus qu’un journal. De sa fondation à nos jours, il est devenu une institution respectée par ses lecteurs dans leur diversité : acteurs politiques du pouvoir comme de l’opposition, intelligentsia, société civile, milieux financiers et citoyens ordinaires. De ce fait, il n’est pas permis qu’il se taise sur les sujets qui fâchent avec le risque de « laisser (ses) moyens de vivre compromettre (ses) raisons de vivre ». Bien au contraire ! « Le Monde » doit ouvrir davantage les yeux et, par ricochet, ses colonnes à tous les dérapages contre la démocratie dans les cinq continents. Et relire Beuve-Méry dans son éditorial fondateur dans le premier numéro du journal paru le 19 décembre 1944 : « Sa première ambition est d'assurer au lecteur des informations claires, vraies et, dans la mesure du possible, rapides et complètes. » Avouons que pour l’édito du 7 août dernier, son « bébé » n’a pas été complet.
L’effroi de la guerre et le froid de l’hiver parisien n’avaient pas refroidi Hubert Beuve-Méry. Loin s’en faut. Il avait le sang chaud pour le journalisme avec le sens qu’il en donnait : le contact et la distance. Tel est l’héritage du Monde.
Mamoudou Ibra KANE
Éditorialiste, leader de « Demain c’est maintenant »
*À la Libération, le général de Gaulle décide de faire appel à Hubert Beuve-Méry pour fonder un journal de référence qui succédera au Temps. Beuve-Méry est lui-même un ancien du Temps, dont il a démissionné en 1938 pour protester contre la ligne éditoriale du journal, favorable aux accords de Munich. Le premier numéro du Monde, qui paraît le 18 décembre 1944 (daté du 19 décembre – il conserve aujourd’hui cette formule de journal de l’après-midi daté du lendemain) manifeste déjà l’ambition du titre : son nom affiche la priorité donnée à l’actualité internationale et sa présentation austère, son refus du spectaculaire. Héritant de l’immeuble de la rue des Italiens et d’une partie de l’ancienne équipe du Temps, il en conserve également le format et la typographie.
Il s’impose peu à peu par son sérieux et son indépendance comme un titre incontournable de la presse française.
*« Le général apparait comme le moindre mal, la moins mauvaise chance » - Verbatim de Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde, à propos du retour, en civil, aux affaires, en mai 1958, du père de la Ve République française.
Publié par
Rédaction iGFM
editor
![]()
iRevue du 16 août
 Il est 14:54 •
Il est 14:54 • 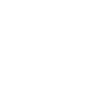 °C
°C
Nous avons sélectionné les meilleurs articles de la journée.
Une revue sera automatiquement générée avec les meilleurs articles du moment sur les différents supports iGFM, Record et L'Obs.
Quand « Le Monde » retourne à La Baule… (Par Mamoudou Ibra Kane)
92 lectures • 0 commentaires
Blog 2 heures
"Réflexion sur la récupération des biens publics après le décès d’un gestionnaire poursuivi"
934 lectures • 0 commentaires
Blog 6 jours
Saly : L’Impact dévastateur des hôtels sur notre Identité et notre économie
5665 lectures • 19 commentaires
Blog 1 semaine
"Le Sénégal ne mérite pas une gouvernance faite de slogans"
1567 lectures • 0 commentaires
Blog 1 semaine
Les maladresses du Préfet Latyr Ndiaye et le courage d’agir de Serigne Mboup
776 lectures • 0 commentaires
Blog 1 semaine
Ils ont peur des femmes qui pensent: À Thomas, ce qui est à Sankara
717 lectures • 0 commentaires
Blog 2 semaines
La lecture continue...
"Le Sénégal ne mérite pas une gouvernance faite de slogans"
1567 lectures • 0 commentaires
Blog 1 semaine
Les maladresses du Préfet Latyr Ndiaye et le courage d’agir de Serigne Mboup
776 lectures • 0 commentaires
Blog 1 semaine
Ils ont peur des femmes qui pensent: À Thomas, ce qui est à Sankara
717 lectures • 0 commentaires
Blog 2 semaines
Soyez le premier à commenter